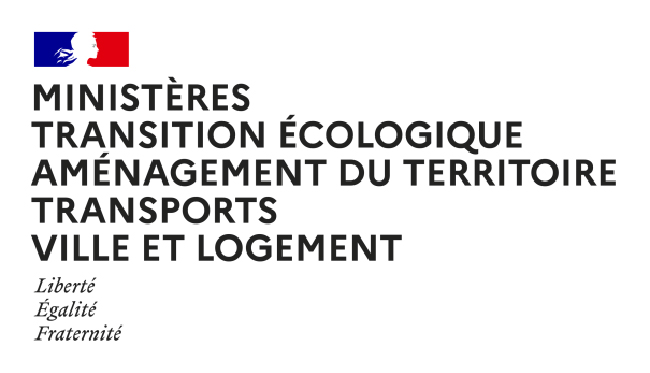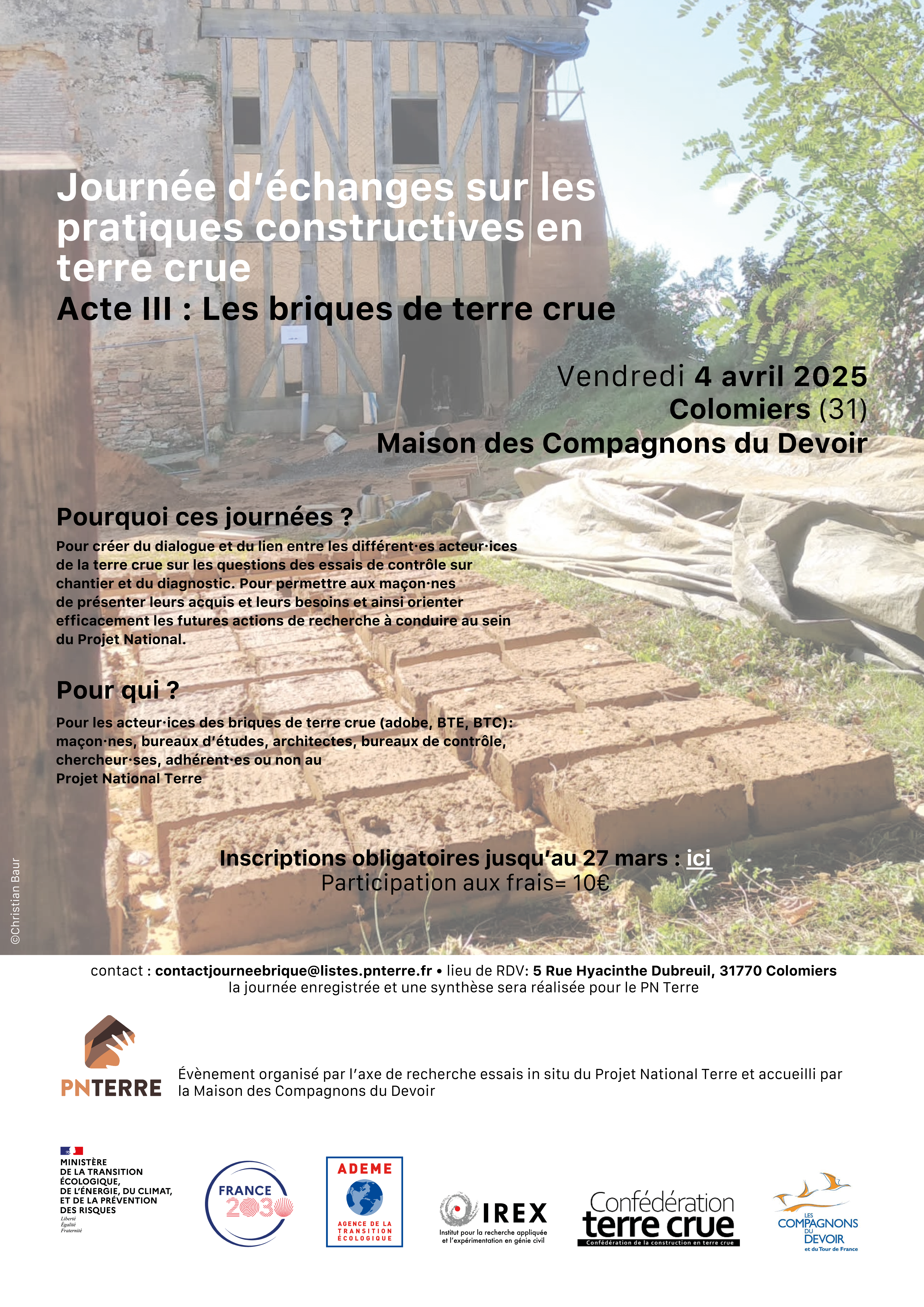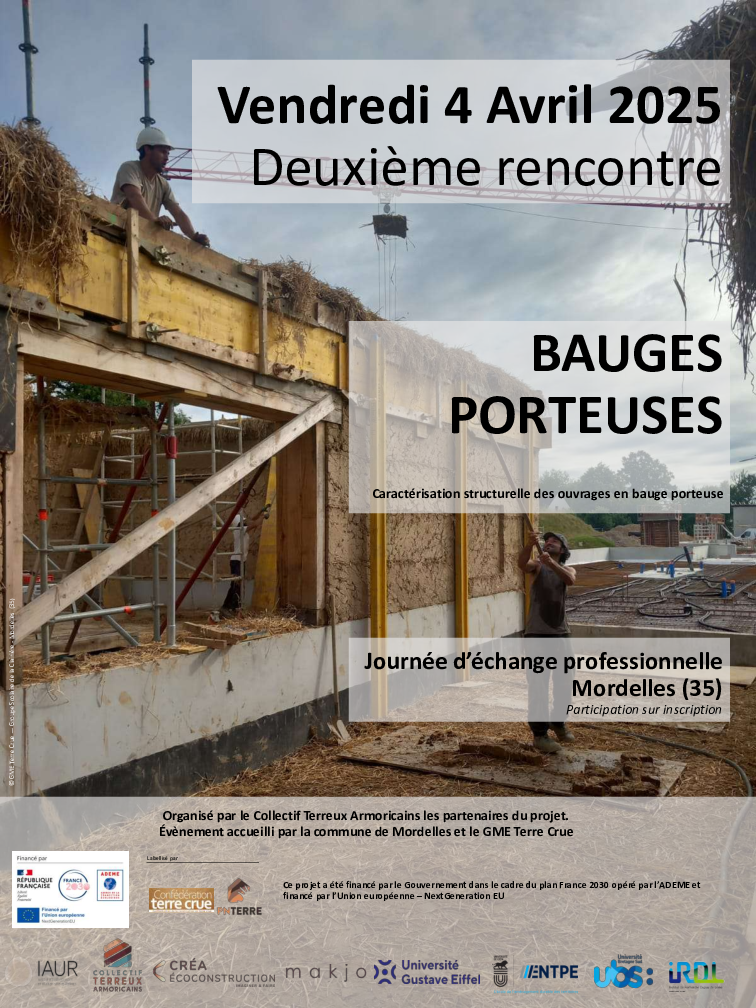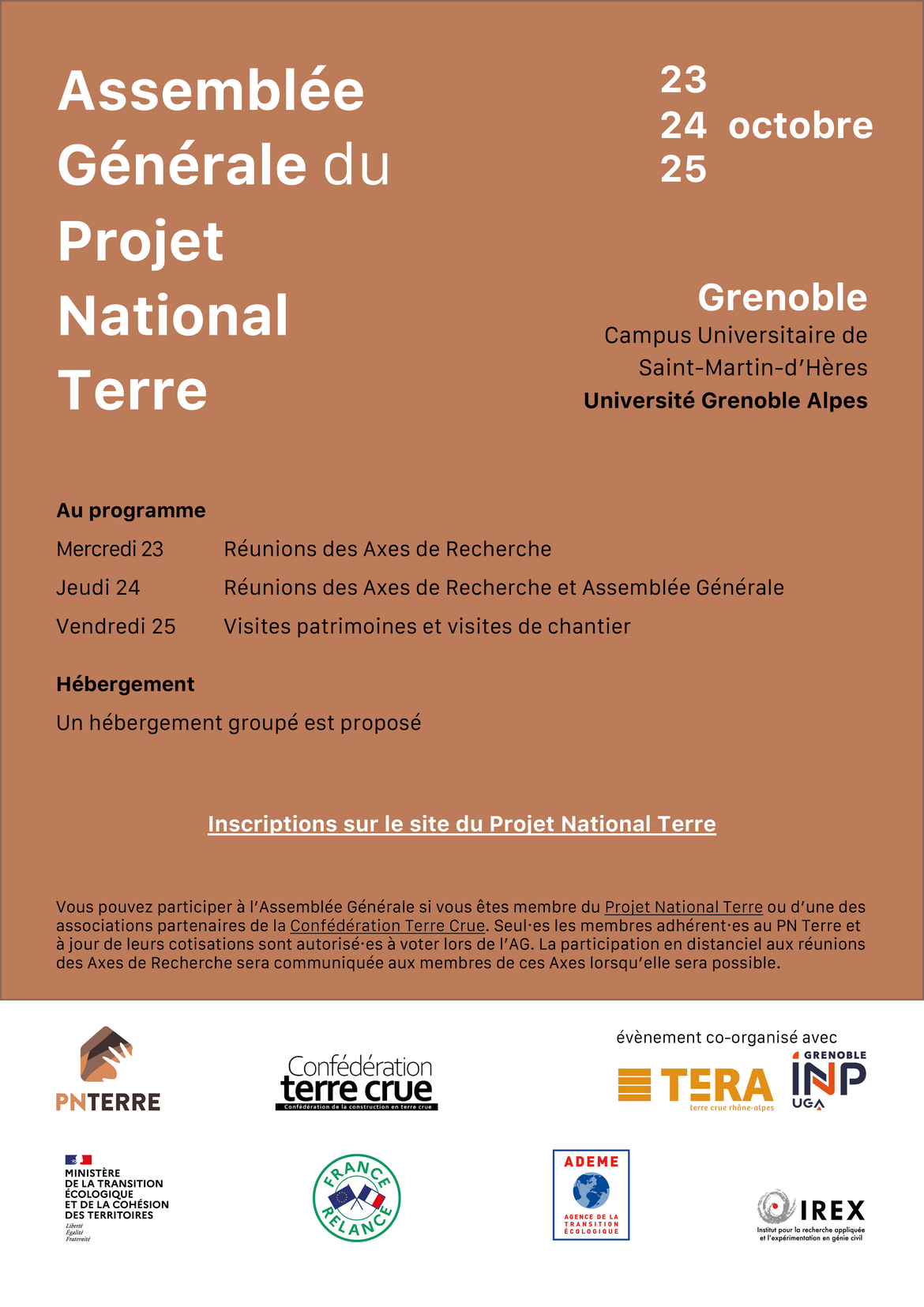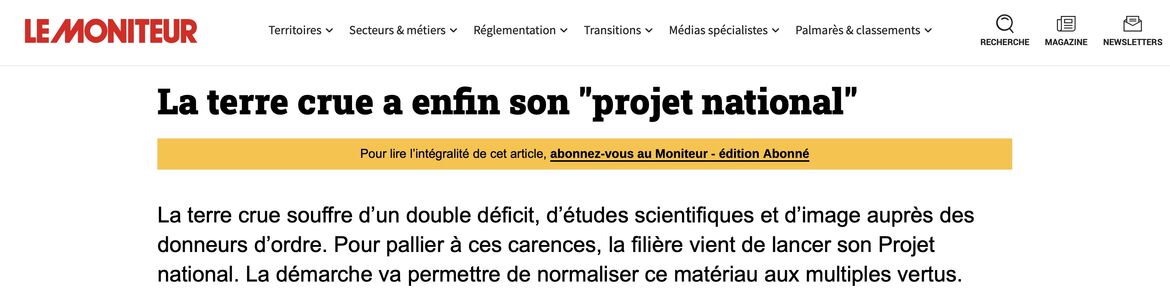Réalisé avec la participation de Marie-Sarah Force, Noemie Prime, Mathieu Audren, Alain Marcom, François Brun, Martin Rueda, Maxime Debroux, Antonin Fabbri et les membres de l’axe essais in situ du projet National Terre.
La terre crue est un matériau qui s’inscrit pleinement dans une logique de circularité, en cohérence avec les évolutions souhaitables dans le monde de la construction. En effet, il s’agit d’une ressource bas carbone, locale et réversible, et d’un mode constructif à fort impact sociétal puisque nécessitant une main d’œuvre qualifiée. La terre crue représente donc un mode constructif à "haut potentiel" dans le cadre de la transition écologique et solidaire, et il importe donc de la réintégrer dans les logiques constructives contemporaines.
Depuis 2021 le Projet National Terre, sous l’égide du Ministère de la Transition écologique, est un projet de recherche appliquée, collaboratif et d’expérimentation en vraie grandeur autour de la terre crue. Son objectif est de faire progresser les connaissances, pratiques, outils et méthodes de la filière, avec notamment un axe de travail qui s’attache à développer et valoriser la pratique de chantier par le développement du contrôle de qualité des éléments d’ouvrages in situ.
Dans ce cadre, une série de journées d’échanges sur les pratiques de contrôle de qualité de la construction en terre a été organisée. Après une journée réalisée sur le torchis en 2023 (le Wast), une seconde journée a rassemblé le 15 mars 2024 ingénieur·es, chercheur·es, maçon·nes, architectes à l’Université Savoie Mont Blanc (Le Bourget-du-Lac) autour du contrôle et de la qualité du pisé. Une première partie des échanges a été consacrée à la qualité de mise en œuvre dans la construction neuve, et une seconde au diagnostic des pathologies et à la rénovation de l'existant. En plus de la mise en réseau des acteurs de la filière terre dans la région Rhône Alpes, les objectifs de la rencontre étaient les suivants :
- Etablir un consensus concernant la notion de qualité dans la construction terre
- Examiner les pratiquesde contrôle existantes dans le neuf et dans l’existant pour atteindre cette qualité
- Identifier les manques, en termes de contrôle, pour orienter les actions de recherche vers de véritables besoins en restant adapté aux contraintes du terrain
- Mettre en évidence les problématiques d’interfaces métiers dans cette recherche de contrôle, qui existent à l’échelle des matériaux ou des corps de métiers. En effet, le point de blocage central à lever est la méconnaissance des pratiques actuelles qui permettent aux maçons de contrôler la qualité de leur production, et aux experts de diagnostiquer correctement les pathologies.
1. La qualité dans la construction terre : une approche performancielle, par objectifs de résultats et non par objectifs de moyens
L’un des enjeux de la construction terre est d’évaluer la qualité par une approche performancielle, plutôt que par une approche normative sur la mise en œuvre du matériau, dans le but de respecter la diversité de la matière première naturelle et de la pratique de l’artisan. Autrement dit, l’objectif est de s’assurer qu’à l’issue de la réalisation, le bâtiment présente bien les performances attendues, indépendamment des méthodes employées pour y parvenir.
Cette approche implique une attention particulière aux performances en service durant toute la vie du bâti, parmi lesquelles :
- Les performances structurelles (statiques et dynamiques),
- La stabilité de l’état hydrique (teneur en eau, comportement au séchage…),
- La durabilité vis-à-vis de l’action de l’eau, des conditions extérieures,
- Le confort pour les usager·es.
En vue de ces performances dans l’état de service, la qualité de mise en œuvre en phase chantier est primordiale, ce qui fait consensus auprès des participant·es à la journée. Une densité sèche régulière au long du chantier et suffisante au regard du projet, peut être considérée pour évaluer l’homogénéité de compactage du pisé. Pour autant, les échanges montrent qu’atteindre une densité cible régulière n’est pas une difficulté particulière pour l’artisan. Par ailleurs, cette donnée ne peut être, à elle seule, gage de qualité.
De la même manière, la résistance à la compression est certes nécessaire pour évaluer la qualité d’un ouvrage mais il apparait, sur la base des échanges, que la considérer comme indicateur unique de performance est trop restrictif. Tout d’abord, l’idée que maximiser la résistance à la compression revient à maximiser la qualité est remise en question. L’objectif est d’avantage d’obtenir une valeur suffisante (et non maximale) de résistance vis-à-vis des spécifications techniques du concepteur. Par ailleurs si pour d’autres matériaux de construction la résistance à la compression peut être utilisée pour extrapoler d’autres paramètres mécaniques (résistances au cisaillement, traction, déformabilité), ce lien est à date moins bien établi pour la terre, naturellement variable. Enfin, la qualité s’évaluant aussi selon la durabilité de l’élément d’ouvrage, d’autres critères doivent être pris en compte comme la résistance vis-à-vis de l’érosion à l’eau, de l’abrasion du matériau ou la sensibilité aux remontées capillaires.
2. Pratiques de contrôle
Les échanges ont permis de distinguer deux aspects du contrôle : d’un côté l’autocontrôle, ou contrôle interne, et de l’autre le contrôle qualité, ou contrôle externe, au sens assurantiel. Bien que certaines méthodes ou types d’essais puissent être communs, les objectifs et usages sont différents.
L’autocontrôle relève d’une démarche qualité propre à chaque praticien·ne. Il est indispensable pour définir les modalités de mise en œuvre, évaluer ou anticiper la qualité, et assurer un suivi régulier sur le chantier. La qualité qui est recherchée par l’autocontrôle peut être celle de la performance structurelle, le séchage, la durabilité, ou la constance de la densité sèche.
Un exemple de pratiques d’autocontrôle par l’artisan·e maçon·ne est le prototypage, qui consiste à réaliser des éléments d’ouvrage de taille réduite en amont du chantier. Son rôle est essentiel pour viser la qualité de mise en œuvre : point de rencontre concret entre le matériau et la pratique, il permet d’explorer les possibilités techniques, esthétiques et économiques de la terre crue en situation réelle et par ailleurs permet de faciliter les échanges entre maître d’ouvrage, bureaux de contrôle et entreprises en rendant visible les choix techniques. Dans le cas du pisé, la fabrication de murets d’essai est notamment recommandée par leguide des bonnes pratiques(GBP). Le prototypage peut donc s’inscrire dans une logique à la fois expérimentale, pédagogique et décisionnelle.
Le contrôle qualité, quant à lui, répond davantage à une logique de justification externe : il vise à rassurer les parties prenantes (maîtres d’ouvrage, bureaux de contrôle, assurances) sur la bonne mise en œuvre ou la performance attendue du pisé. Il peut instaurer de la confiance, mais aussi s’apparenter à une surveillance formelle, parfois lourde voire excessive.
Par exemple, l'assimilation du pisé à des logiques issures de la géotechnique ou des travaux publics, en raison de sa proximité avec le sol comme matériau, entraîne des exigencesparfois inadaptées aux réalités du chantier, telles que des demandes systématiques de caractérisation de la nature de la terre. Bien que ces essais permettent de connaître plus en détails la terre, ils sont parfois utilisés pour orienter des choix techniques sans réelle corrélation démontrée avec les performances du matériau ou de l'ouvrage. Ils sont remis en question par des artisans de la terre pour plusieurs raisons : ils ne sont pas garants d'une performance en termes de densité et de résistance, et ajoutent de la complexité d'analyse ainsi que des surcoûts. Leur pertinence doit donc être réévaluée en fonction des spécificités de chaque projet.
Les échanges de la journée ont permis de recenser un ensemble d’essais de contrôle actuellement demandés pour les constructions en pisé, avec les avantages et limites de chacun. Ceux-ci sont rassemblés dans le tableau suivant. Cette synthèse est donnée à titre d’illustration pour mettre en évidence la complexité des essais demandés et n’a pas pour but d’être exhaustive ni représentative de l’ensemble des projets de construction en pisé.
Essai de contrôle | Type d’information | Objectif | Avantages | Limites / Questions |
Contrôle du mélange et du stockage | Vérifier la qualité du matériau avant mise en œuvre | - Surveillance de la teneur en eau | - Méthodes encore peu standardisées | |
Prototypage (muret d’essai – GBP) | Qualitatif, expertise par l’artisan·e. | Tester la mise en œuvre et la finition
| - Plus représentatif qu’un échantillon (petite dimension) | - Peut générer des coûts et des délais supplémentaires |
Courbe granulométrique, VBS, indice de plasticité (IP) | Quantitatif | Identifier une terre et sa variabilité | - Permet de comparer le stock de terre utilisé sur un chantier | - Test coûteux qui apporte peu d’informations exploitables |
Contrôle de mise en œuvre | Vérifier la qualité du chantier et confirmer une homogénéité dans la mise en œuvre. | - Surveillance des hauteurs et régularité des couches | - Dépend fortement de l’expertise des intervenant·es | |
Résistance à la compression / traction | Quantitatif | Évaluer la résistance mécanique du matériau | Indication directe du comportement structurel | - Fabrication d’échantillons nécessaire |
Résistance à l’abrasion | Quantitatif | Tester la tenue en surface | - Essai peu coûteux et facile à mettre en œuvre | - Quelle corrélation avec le comportement du matériau à long terme ? |
Résumé des méthodes de contrôle évoquées lors de la journée d'échange sur le pisé
3. Orienter la recherche vers des besoins en termes de contrôle
Les échanges ont mis en évidence que la question de l’autocontrôle et des protocoles d’évaluation n’est pas tant une question de complexité technique, mais plutôt une question de savoir quoi faire, comment, et dans quel but, et qui partage, ou non, la responsabilité.
À ce jour, les appuis scientifiques restent marginaux pour les projets et il existe un réel manque d’essais adaptés pour caractériser les propriétés et performances du pisé de manière applicable sur chantier, représentatif de la réalité de l’ouvrage, et fiable scientifiquement.
Les besoins de recherche ont été formulés autour de plusieurs axes :
- Attester ou améliorer la fiabilité des essais existants, afin de garantir des résultats précis et exploitables pour valider les ouvrages,
- Développer des outils de mesure sur site, notamment pour la densité et la teneur en eau du matériau (des travaux sont en cours),
- Étudier le comportement des ouvrages soumis au vieillissement (abrasion, action de l’eau liquide, gel/dégel) une problématique de durabilité encore peu documentée,
- Mieux comprendre le processus de séchage sur chantier, en tenant compte des phasages, des conditions climatiques et des interactions avec d’autres corps de métier.
La durée de séchage est souvent estimée « à l’expérience » (par exemple trois semaines), mais la question du temps d’attente nécessaire avant de poursuivre le chantier reste floue, et aucune méthode de vérification n’est standardisée. Prévoir et anticiper le temps de séchage peut engendrer des tensions sur les délais, des surcoûts ou des blocages notamment dans le cas de chantiers pour lesquels de fortes interfaces existent entre l’artisan·e piseur et les autres corps de métiers.
S'inspirer du patrimoine pour la construction neuve : intérêt et limites
Les artisan·es spécialisé·es dans la construction en pisé sont souvent aussi des professionnel·les ayant une expérience du bâti ancien. Le savoir-faire traditionnel constitue une ressource précieuse, en particulier pour pallier le manque de formation actuelle des acteurs et actrices de la construction.
Le patrimoine offre des exemples concrets, souvent durables, qui permettent de démontrer lespossibilités constructives de la terre, tout en constituant un support pédagogique efficace. Ignorer ces savoir-faire serait une erreur et comprendre les techniques vernaculaires, au-delà du pisé, est essentiel pour progresser collectivement. Les chercheur·es sont ainsi invité·es à reconnaître, documenter et faire reconnaître scientifiquement les savoir-faire vernaculaires dans une société marquée par l’industrialisation.
Analyser le bâti ancien permet de comprendre comment il a été réalisé et pourquoi il fonctionne encore aujourd’hui. Cependant, la performance et la réglementation attenduesaujourd’hui (en matière thermique, sismique, assurantielle, feu…) diffèrent des constructions anciennes.
4. Les difficultés liées au contrôle qualité : interfaces métiers
La principale problématique réside dans la différence d’approche entre l’autocontrôle par l’artisan·e et le contrôle qualité externe. L’autocontrôle est indispensable pour obtenir une constance dans la mise en œuvre et porte aussi sur la performance finale de l’élément d’ouvrage. Le contrôle qualité, bien qu’impliquant des coûts, peut contribuer à faciliter la réalisation d’un projet. Il peut, par exemple, éviter le recours à une ATEx (Appréciation Technique d’Expérimentation), permettant ainsi des économies de temps et d'argent. C’est en général sur ce contrôle externe, plutôt que sur l’auto-contrôle, que se base la confiance des assureurs.
Les démarches d’autocontrôle et de contrôle qualité gagneraient à converger, mais plusieurs limites ont été soulevées. Concernant l’autocontrôle ces limites sont les suivantes :
- Les méthodes d’autocontrôle varient beaucoup selon les pratiques et ne sont pas standardisées (par exemple, plusieurs protocoles existent pour la fabrication d’échantillons).
- La fiabilité de certaines méthodes d’autocontrôle est encore mal connue, voire non attestée.
- À l’inverse, certaines méthodes fiables ne sont pas reconnues faute de visibilité ou de validation scientifique (elles ne sont pas reconnues par les bureaux de contrôle).
- L’existence d’un autocontrôle interne n’est pas toujours vérifiée ni questionnée dans le processus.
Concernant les contrôles de qualité externe, il a été souligné les problématiques suivantes :
- Ils nécessitent un surcoût important (associés à l’obligation de résultat) et n’est pas réparti équitablement entre les différent·es acteurs et actrices.
- Leur pertinence doit être réfléchie en fonction de chaque projet, notamment la catégorie du bâtiment (public, privé, ERP ou non), la présence d’enjeux sismiques, le caractère neuf ou existant de l’ouvrage, la taille du projet. Dans le cas de petits projets ou de rénovations, le besoin en contrôle qualité peut être limité.
- La pertinence des demandes dépend également de la qualification, ou de la confiance placée en l’entreprise, notamment si elle est expérimentée. Cependant, même sur des projets modestes, un contrôle peut rester pertinent lorsque l’entreprise est encore peu expérimentée.
- En l’absence de cadre réglementaire, certains contrôles peuvent être demandés sans justification technique.
Dans les 2 cas de figures, le contrôle nécessite un temps supplémentaire de chantier et un surcoût de l’opération qu’il est important d’anticiper pour une bonne budgétisation et planification.
Le dialogue en amont : une méthode pour initier la qualité dès la conception
La qualité d’un ouvrage ne dépend pas uniquement des performances du matériau utilisé, mais bien d’une approche globale du projet. Un véritable dialogue en amont est indispensable, notamment au moment de la conception et de la rédaction des CCTP (cahier des clauses techniques et particulières), afin de s’assurer que le projet est cohérent avec les "règles de l’art" et adapté à la mise en œuvre en pisé. Notons que le terme de "dialogue" mis en avant dans les échanges du jour, est préféré à la notion de ‘contrôle’. Bien en amont, le quadrillage du projet entre les parties prenantes et leur coordination est nécessaire.
Des retours d’expérience montrent que certains CCTP ou plans proposent des solutions techniques excessives. Dans ces situations, les maçon·nes se retrouvent alors dans une position délicate : devoir suivre des prescriptions inadaptées, tout en questionnant leur pertinence. Une exécution conforme à un projet mal conçu peut, in fine, servir de contre-exemple et desservir l’image du pisé. Dans un contexte ou la construction en pisé reste marginale, chaque projet doit être exemplaire. Une réalisation mal pensée peut avoir des conséquences importantes pour la filière.
Le principal défi réside dans la nécessité pour tous les acteurs et toutes les actrices de suivre le Code des Marchés Publics qui impose à tous les acteurs de suivre les mêmes règles, souvent peu compatibles avec les spécificités de la terre. Lors des appels d’offre, les projets ne sont pas toujours bien définis et il reste techniquement difficile pour les entreprises d’y répondre.
Par ailleurs, un autocontrôle de l’architecte ou du bureau d’études en phase APD permettrait d’anticiper ces dérives, d’éviter des corrections coûteuses et de mieux intégrer les contraintes propres à la terre.
Une coordination en amont entre tous les acteur·ices est déterminante afin de faire intervenirles bons interlocuteurs au bon moment, la bonne entreprise, et d’intégrer au plus tôt dans le projet les maçon·nes mais également les bureaux de contrôle. Des projets bien accompagnés dès les premières phases (conception, appel d’offres) par des professionnel·les acculturé·es à la terre permettent parfois d’éviter un contrôle qualité excessif, en s’appuyant sur le dialogue avec les bureaux de contrôle et d’études.
Enfin, une bonne gestion des interfaces entre métiers est essentielle pour limiter la sinistralité. Les problèmes rencontrés sur les chantiers relèvent rarement d’un seul facteur, mais résultent d’un enchainement d’incohérences entre charpentiers, maçons, menuisiers, etc.
Un autocontrôle du projet dans son ensemble, dès les premières phases, est donc recommandé. Il pourrait être complété par un plan de contrôle qualité partagé, reproductible d’un chantier à l’autre.
La popularité croissantede la construction en terre attire de nouveaux acteurs… qui manquent parfois des connaissances et compétences nécessaires pour piloter efficacement ce type de projet (architectes, contrôleur·es techniques, ingénieur·es d’étude, maçon·nes). Ainsi, un besoin important en formation aux techniques constructives en terre crue a ainsi été clairement identifié lors de la journée, constat s’appuyant sur un état des lieux de la formation en France réalisé par la Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB). De même, actuellement, il n’y aurait aucune formation adaptée pour les ingénieurs sur l’utilisation de matériaux vernaculaire et très peu pour les architectes, alors qu’à l’inverse, il est nécessaire que tous les acteurs de la chaîne de conception et de réalisation d’un projet en pisé (bureaux d’études, bureaux de contrôle, maîtres d’ouvrage…) soient acculturés à la terre.
Conclusion
En conclusion de cette journée, les enjeux de la qualité de la construction neuve et de la rénovation ont été discutés, et quelques constats ont pu être dégagés.
En premier lieu, la qualité a été abordée comme une finalité, par une approche par objectif de résultat et plébiscitée pour être en cohérence avec des performances suffisantes à l'échelle des projets et non maximisées. Dans la pratique, l'autocontrôle sur chantier et le contrôle externe ont été perçus comme deux approches complémentaires.
L’importance du dialogue dès la conception entre toutes les parties prenantes et la nécessité de temps pour l’accompagnement des projets ont également été identifiés comme déterminants pour la réussite des projets. Engager du temps et de l’énergie pour instaurer la confiance et le dialogue semble être le meilleur levier pour mener à bien un projet de bâtiment en terre crue.
Cependant, des points de difficulté forts ont été identifiés en ce qui concerne la prise en compte logistique du contrôle : le temps nécessaire doit être anticipé, et le surcoût doit être budgétisé et réparti de manière appropriée entre les acteurs du projet.
La confiance en la conscience professionnelle des acteur·ices de la construction est essentielle pour garantir une réalisation de qualité, mais elle rencontre des limites, notamment d’ordre réglementaire, avec des interlocuteurs différents selon le type ou la taille de projet. Même avec une amélioration de la formation, le besoin de s’appuyer sur des méthodes et des essais de contrôle persiste.
--